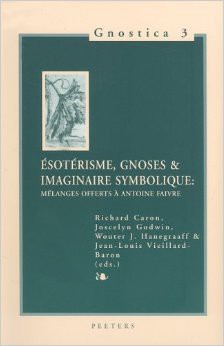1. Une culture de l’ambiguïté
L’équivoque et le double sens sont l’apanage de la maçonnerie rectifiée depuis son premier essor. Cet héritage lui vient en droite ligne de la Stricte Observance Templière (SOT).
En effet, dès les années 1760-1770, les « loges réunies et rectifiées selon la réforme de Dresde », sous les apparences convenues et rassurantes d’une franc-maçonnerie classique, préparaient en fait le candidat à découvrir, le jour venu, qu’il était en réalité entré dans l’Ordre du Temple. Le point nodal où s’articulait cette « révélation » était le 4ème grade, dit « Écossais vert », dont les rituels nous sont parvenus. On y annonçait au candidat qu’il allait être délivré « du joug de la maçonnerie symbolique » et que l’Ordre allait paraître à lui dans toute sa vérité. Admis enfin dans « l’Intérieur », dont le grade d’Écossais faisait alors partie, il pouvait avancer vers la chevalerie du Temple.

Symbole du 4ème grade du RER
Cette dissimulation provisoire du vrai but de l’Ordre avait des conséquences sur les structures ou du moins sur leur présentation. L’expression « l’Intérieur » – là où se tenait le vrai pouvoir de l’Ordre – n’était pas un vain mot : il n’était pas connu de l’extérieur…
En 1778, au Convent de Lyon, les Français entreprirent de revoir l’organisation de l’Ordre. On se souvient qu’ils y avaient été incités par au moins deux sortes de motifs :
- En premier lieu, remettre en cause la question de la filiation templière, trop douteuse et surtout trop embarrassante, voire compromettante en France ;
- En second lieu, mettre au net les relations entre les Frères, les Loges et les Supérieurs de l’Ordre, pour passer d’une culture aristocratique et militaire – celle des fondateurs allemands – à une culture plus spécifiquement maçonnique et communautaire – on ose à peine dire « démocratique » –, convenant mieux à une branche française surtout composée d’honnêtes bourgeois.
Or, sur ces deux points, le Convent des Gaules ne put adopter de solution tranchée. On ne renonça pas entièrement aux liens avec l’Ordre du Temple [1] et l’on se borna à changer la dénomination des classes chevaleresques après en avoir réécrit les rituels : c’est la naissance des Chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte.
D’autre part, s’agissant de la nature du pouvoir exercé au sein de l’organisation, l Titre IV (« Du gouvernement de général l’Ordre ») en son article 1(« Nature du gouvernement »), le Code général des CBCS est éloquent par son habileté :
« Le Gouvernement de l'Ordre est aristocratique, les Chefs ne sont que les Président des Chapitres respectifs. Le Grand Maître général ne peut rien entreprendre sans les avis des Provinciaux. Le Maître provincial sans celui des Prieurs et des Préfets, les Préfets sans celui des Commandeurs et ceux-ci sans en avoir conféré avec les Chevaliers de leur district. Tous les Présidents d'assemblées, Maîtres provinciaux, grands Prieurs et Préfets ont toujours le droit après l'exposé de la matière fait par le Chancelier, la 1″ voix consultative et la dernière délibérative. »
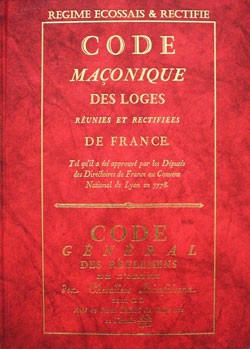
On mesure toutes les ressources dialectiques des rédacteurs de ce petit chef d’œuvre d’équivoque. On explique benoîtement que le caractère « aristocratique » de l’Ordre signifie avant tout qu’il n’est en aucun cas monarchique. C’est bien sur cette alternative qu’on fait ici peser l’opposition et non sur l’alternative démocratique qui, sans être mentionnée explicitement, remporte clairement la préférence des bourgeois lyonnais. Ces mêmes hommes, au demeurant, qui dès l’origine avaient déjà discuté des obligations financières envers l’Ordre avec la même ardeur que lorsqu’ils marchandaient l’impôt dû au Roi de France...
Sans vouloir ironiser, on pourrait dit que c’est là un trait typiquement rectifié : s’exprimer par antiphrase…
2. Les structures originelles du Régime
Les deux textes fondamentaux adoptés en 1778 en sont une parfaite illustration [2].
Le Code maçonnique des loges réunies et rectifiées expose l’organisation générale de la partie maçonnique du Régime : aucune allusion n’y est faite à l’Ordre intérieur.
Le RER se compose donc, selon ce document, de quatre grades – car le grade de Maître Écossais avait été retranché de l’Intérieur et rendu « ostensible », comme n’importe quel grade maçonnique à cette époque. Notons dès à présent cette particularité du RER sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre suivant : c’est un système maçonnique composé de quatre grades symboliques.
L’organisation du Régime, si elle fait place à quelques dénominations alors peu usitées, demeure assez classique quoique très hiérarchisée. L’ensemble est placé sous l’autorité d’un Grand-Maître général et de Grands Maîtres nationaux présidant chacun un Grand Directoire national. On distingue en fait quatre échelons essentiels :
- Les grands Directoires provinciaux, la France comprenant trois Provinces, aux limites redéfinies par la Matricule nouvelle des provinces françaises adoptée par la Convent. Deux de ces Provinces (la IIème dite d’Auvergne dont le siège est Lyon, et la IIIème dite d’Occitanie dont le siège est Bordeaux) lui sont propres, une autre (la Vème, de Bourgogne, dont le siège est à Strasbourg) s’étendant aux Pays-Bas autrichiens (l’actuelle Belgique) et à l’Helvétie.
- les Directoires Écossais au nombre de trois par Province et dont les ressorts géographiques sont également clairement stipulés par la Matricule. C’est à eux qu’il revient de constituer et de régir les loges de leur district. Ils comprennent un Président, le Visiteur du district et un Chancelier, tous inamovibles.
- les Grandes Loges Écossaises établies dans chaque district, comprenant notamment des Députés-Maîtres, dignitaires inamovibles, nommé par la Grande Loge écossaise et chargés d’inspecter les Loges de leur arrondissement particulier.
- les loges réunies et rectifiées elles-mêmes, chacune dirigée par son Comité écossais composé exclusivement de tous les Maîtres écossais de la loge et présidé par le Vénérable-Maître choisi parmi eux.
Le Code général des règlements de l’Ordre des CBCS, deuxième texte fondamental, semble décrire toute cette organisation selon le même plan mais avec une autre terminologie, comme s’il s’agissait de tout autre chose : il y a ainsi trois Grands Prieurés dans chacune des neuf Provinces. Chaque Grand Prieuré comprend six Préfectures. Pour constituer une Préfecture, il faut au moins trois Commanderies qui sont les cellules de base de l’Ordre, rassemblant les CBCS présents dans un lieu géographique donné.
C’est alors que l’on peut lever l’équivoque de cette « double structure ». Il existe en effet des équivalences tacites mais parfaites entre les deux systèmes :
- Une Province correspond à un Grand Directoire provincial ;
- Un Grand Prieuré s’identifie à un Directoire Écossais ;
- Une Préfecture équivaut à une Grande Loge Écossaise.
Seule la Commanderie, cellule de base de l’Ordre des CBCS telle que définie plus haut, n’a pas de strict équivalent « maçonnique ». Encore une fois, il ne s’agit pas ici de deux organismes identiques et parallèles mais d’un seul et même édifice qualifié de façon différente selon le point de vue qu’on adopte. Il en va de même pour les dignitaires du Régime : il faut ainsi retenir que le Président d’un Grand Directoire Écossais n’est autre qu’un Grand Prieur et que le Président d’une Grande Loge Écossaise [3] est en réalité un Préfet. Quant aux Députés-Maîtres des loges, ce sont, dans l’Ordre intérieur, des Commandeurs : s’ils président naturellement à leur Commanderie, leur autorité sur les loges dont ils sont à la fois les inspecteurs et les députés, n’est pas moindre. Les textes précisent même : « Chaque Loge lui adjoint tous les trois ans un Vénérable pour la gouverner sous son autorité»…
Cette disposition initiale du Régime – et le mot « Régime » prend ici tout son sens – permet de comprendre au moins deux choses.

Premièrement, le caractère profondément hiérarchique du RER – ce qui ne veut pas dire autoritaire ou despotique – était l’un des points qui avaient d’emblée séduit les premiers rectifiés français. Le RER, plus généralement, a hérité de cette image d’ordre, de netteté dans son organisation. Il s’y trouve, en quelque sorte, une « tentation pyramidale » qui peut certes donner le vertige et même égarer, mais qui est aussi faite pour suggérer que le système, dans son ensemble, pris comme un tout que ses structures suggèrent, précisément, possède un sens profond et unique.
Il faut cependant noter que cette organisation impressionnante ne fut jamais pleinement mise en place. Certes, les principaux dignitaires furent désignés mais les maigres troupes du RER, au XVIIIème siècle, lui donnèrent un peu l’aspect d’une « armée mexicaine » où de nombreux Frères étaient revêtus de multiples dignités. En outre, la Matricule décrit un réseau européen parfaitement illusoire. Même en France, jamais ce fantastique puzzle ne fut rempli, même au dixième…[4]
Le deuxième point concerne l’histoire postérieure du RER. Après son éclipse du XIXème siècle, lors de la reconstitution française des années 1910, il eut d’emblée du mal à trouver sa place. Depuis le début du XIXème, en effet, une sorte de dogme s’était imposé, aussi bien en Angleterre qu’en France, tendant à séparer nettement grades bleus et hauts grades, au point même de ne parler de ces derniers qu’avec d’infinies précautions, avec un peu de crainte, comme de quelque chose de presque incongru.
Or, telle n’était pas l’esprit de la franc-maçonnerie au XVIIIème siècle, où tous les grades étaient « ostensibles » et portés comme tels dans la loge, en un temps où, du reste, les trois grades bleus étaient généralement considérés comme étant sans réel intérêt [5].
Si la SOT, puis le premier RER, « masquaient » l’Ordre intérieur sous des artifices de terminologie, ce n’était pas du tout dans l’optique moderne, mais uniquement parce que le but templier devait rester sinon secret du moins discret. Pour autant, il ne s’agissait nullement, à leurs yeux, de séparer le moins du monde les loges symboliques de l’Ordre chevaleresque. Bien au contraire, la « double structure » de l’Ordre permettait en fait, sans qu’on le sût vraiment, de placer les loges bleues sous le gouvernement de dignitaires nommés par l’Ordre intérieur !
Au XXème siècle, les standards de la vie maçonnique n’autorisaient plus de tels montages. D’où la diversité des solutions adoptées depuis lors…et les innombrables quiproquos et querelles qu’elles ont suscités !
* Ce post est très inspiré d'un chapitre du "Que sais-je ?" Le Rite Écossais Rectifié, que j'ai co-écrit avec Jean-Marc Pétillot, PUF, 2010.
[1] Du reste, l’Acte de renonciation qui sera adopté en 1782 à Wilhelmsbad, ne sera pas non plus exempt d’ambiguïté…
[2] Ils ont été reproduits en annexes du livre de J. Tourniac, Principes et problèmes spirituel du Rite Ecossais Rectifié et de sa chevalerie templière, Dervy, Paris, 1969.
[3] Au début du XIXème siècle on parlera plutôt de « Régence Écossaise ».
[4] Pour ne s’en tenir qu’au ressort géographique de la France d’alors, on pouvait théoriquement compter, selon la Matricule, 42 Préfectures correspondant à 126 Commanderies au moins…
[5] Sur ce point, les rituels du RER les avaient considérablement enrichis mais en faisant d’eux une propédeutique qui devait conduire un jour où l’autre « à de meilleures choses ».
 On se souvient de la geste cosmogonique et anthropogonique que rapporte Martinès dans son Traité – récit qui n’est qu’une glose de l’Ancien Testament et s’inspire en partie de la littérature midrashique, et notamment de Genèse Rabbah. Or, cette fresque mythique présente la condition de l’homme comme celle d’un prisonnier, jeté dans la matière en punition (Martinès dit « en pâtiment »), conséquence de sa faute (que Martinès appelle sa « prévarication »). De ce constat on a pu déduire, hâtivement et par erreur, je crois, que le martinèsisme était gnostique. Il ne fait pourtant que paraphraser toute la tradition vétéro-testamentaire, et que reprendre aussi, au passage, la fameuse allitération des pythagoriciens – « sôma, sèma », c’est à-dire, « le corps est un tombeau ». Nulle part Martinès, dans son Traité, ne laisse entendre que la matière est l’œuvre d’un Dieu mauvais, d’un Démiurge pervers qui veut nous tromper, s’opposant au Dieu bon qui aspirerait à ce que nous quittions la fange du monde.
On se souvient de la geste cosmogonique et anthropogonique que rapporte Martinès dans son Traité – récit qui n’est qu’une glose de l’Ancien Testament et s’inspire en partie de la littérature midrashique, et notamment de Genèse Rabbah. Or, cette fresque mythique présente la condition de l’homme comme celle d’un prisonnier, jeté dans la matière en punition (Martinès dit « en pâtiment »), conséquence de sa faute (que Martinès appelle sa « prévarication »). De ce constat on a pu déduire, hâtivement et par erreur, je crois, que le martinèsisme était gnostique. Il ne fait pourtant que paraphraser toute la tradition vétéro-testamentaire, et que reprendre aussi, au passage, la fameuse allitération des pythagoriciens – « sôma, sèma », c’est à-dire, « le corps est un tombeau ». Nulle part Martinès, dans son Traité, ne laisse entendre que la matière est l’œuvre d’un Dieu mauvais, d’un Démiurge pervers qui veut nous tromper, s’opposant au Dieu bon qui aspirerait à ce que nous quittions la fange du monde.