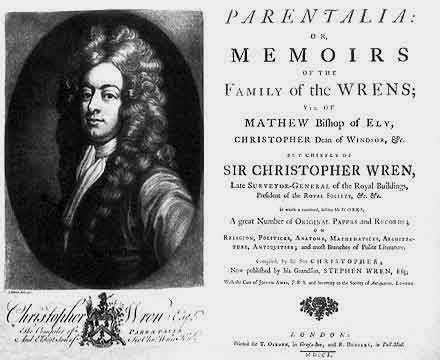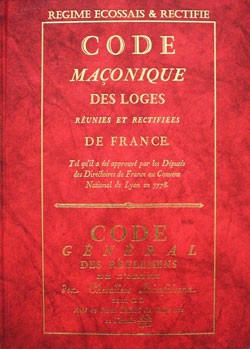Beaucoup des francs-maçons se souviennent sans doute qu’on a célébré en 2003, par de nombreux événements tant officiels que culturels et scientifiques, le « 275ème Anniversaire de maçonnerie française » : je revendique ici d’avoir déterminé l’année à laquelle se rapportait cette célébration, et d’avoir indiqué la nature de l’évènement qui s’y était produit.
La vérité des faits est encore plus précise : en 2002, Alain Bauer, qui entamait alors la dernière année de son mandat de trois ans à la tête du Grand Orient, me demanda un jour s’il serait envisageable, justifiable historiquement, de marquer l’année 2003 par le rappel d’un événement important ou significatif de l’histoire maçonnique française autour duquel toutes les Obédiences, qui traversaient alors une période de grâce dans leurs relations, pourraient se rassembler. Au terme d’une brève réflexion, l’année 1728 nous vint assez rapidement à l’esprit malgré le caractère assez inhabituel – mais pas totalement inusité – d’un « 275ème anniversaire » : onze ans plus tôt, en 1992, la Grande Loge Unie d’Angleterre elle-même avait bien fêté à grands fracas le 275ème anniversaire de la création de la première Grande Londres, à Londres en juin 1717 !
Les diverses récupérations de cette date de 1728 qui ont lieu depuis lors, pour des raisons obédientielles que je ne juge pas mais qui ont peu de rapport avec le souci de l’exactitude historique m’obligent, afin que la mémoire ne s’en perde pas, à la présente mise au point en forme de réponse à la question suivante : que s’est-il vraiment passé en 1728 en France, dans le domaine maçonnique ?
La réponse la plus lapidaire – si j’ose dire – tiendrait du reste en peu de mots : presque rien…
Cela nécessite évidemment une explication plus substantielle.

Des débuts obscurs
Nul ne sait au juste quand les premiers francs-maçons ont paru sur le sol français. Il existe en fait deux thèses dont l’une est pratiquement sans fondement documentaire alors que l’autre repose sur des preuves indiscutables. Il reste qu’elles ne sont nullement incompatibles.
L’une affirme que les deux premières loges en France furent, dès 1688, celles de La Bonne Foy, du régiment de Dillon des Gardes écossaises et de La Parfaite Egalité, à l’Orient du régiment de Walsh-Infanterie. Ces deux loges mythiques appartiennent en effet au légendaire doré de la franc-maçonnerie française. Le lieu n’est pas ci de reprendre en détail ce dossier mais d’observer, après tant d’autres historiens qui ont confronté les maigres données disponibles, que rien ne permet d’affirmer l’existence réelle de ces deux loges – mais que rien non plus ne permet de l’exclure. Il est parfaitement vraisemblable que des francs-maçons, sinon des loges, aient été présents sur le sol français à cette époque, dans une émigration d’environ 20 000 à 30 000 personnes de souche britannique venues s’établir en France, suite à l’exil jacobite.
La deuxième étape, documentairement indiscutable, en revanche, est celle de la fondation à Paris, vers 1725, d’une loge rue des Boucheries. Lalande, l’un des plus anciens témoins de la première maçonnerie française, nous en a laissé un célèbre récit dans le supplément de l’Encyclopédie publié en 1773 :
« Vers l’année 1725, Milord Dervent-Waters, le Chevalier Maskelyne, d’Herguerty, & quelques autres Anglois établirent une Loge à Paris, rue des Boucheries, chez Huré, Traiteur Anglois, à la manière des sociétés angloises ; en moins de dix ans, la réputation de cette Loge attira cinq ou six cens Frères à la Maçonnerie, & fit établir d’autres loges ; […] »
Des francs-maçons, il y en donc eu en France avant même qu’il y ait peut-être des loges, et donc avant que l’on puisse parler d’une franc-maçonnerie organisée : en 1688, il n’existe de « Grande Loge » nulle part au monde et, en 1725, la jeune Grande Loge de Londres et Westminster est encore très confidentielle et ne compte alors que quelques dizaines de loges, non loin du cœur de la capitale anglaise.
Dans ces conditions, pourquoi assigner la date de 1728 aux origines de la maçonnerie en France ?
Pour le comprendre, il faut faire un détour par l’Angleterre, à la découverte d’un singulier personnage…
L’improbable Wharton
Raconter la vie de « sa Grâce le Duc de Wharton » n’est pas une mince affaire. En quelques mots, un aristocrate pourvu de quelques dons mais velléitaire, fantasque, débauché, multipliant les allégeances et les trahisons dans une Angleterre déchirée par le conflit dynastique entre les Hanovre et le Stuart…
Dans des conditions plus que douteuses, il devint en 1722 Grand Maître de la Grande Loge de Londres, succédant au probe duc de Montagu, mais quitta sa charge l’année suivante dans des circonstances tout aussi mouvementées. Devenu ouvertement jacobite après avoir cultivé toutes les équivoques, sa situation politique étant devenue intenable et les créanciers se précipitant à ses trousses, il quitta l’Angleterre sans esprit de retour en 1725, pour une errance de quelques années en Europe. Il finit assez piteusement ses jours en Espagne, malade et alcoolique au dernier degré, en 1731.
En 1735, un document essentiel fut rédigé par celui qui, cette année-là, « assumait » la fonction de « Grand Maître » : Hector Mc Leane, écossais de naissance, justement l’un des trois fondateurs de la première loge à Paris ! Les Devoirs enjoints aux maçons libres, adaptation très libre – mais riche d’enseignements – des Constitutions anglaises de 1723, est ainsi l’un des textes les plus précieux de la tradition maçonnique française. Or, dans ce texte, Mac Leane fait figurer la mention suivante, capitale pour notre sujet :
« [Ces règlements généraux] furent modelés sur ceux donnés pat le Très Haut et Très Puissant Prince Philippe, duc de Wharton, Grand Maître des Loges du Royaume de France ».
Le reste est simple : la biographie mouvementée de Wharton, aujourd’hui parfaitement connue[1], permet d’établir sans erreur qu’il séjourna à Paris entre juin 1728 et avril 1729. C’est donc à cette époque, à nulle autre, qu’il put être reconnu comme « Grand Maître » en France.

Frontispice des Constitutions de 1723
Wharton est à droite
Wharton avait été Grand Maître en Angleterre – d’une manière très controversée, certes, mais on avait fini par « régulariser » son élection. C’est sans doute parce que la très petite communauté maçonnique de Paris, en 1728 – alors évidemment composée d’une majorité de sujets britanniques – partageait ses engagements politiques, qu’elle ne fit aucune difficulté pour lui accorder le titre de Grand Maître, en France également. Une façon de dire que les loges, en France, ne dépendaient plus de la Grande Loge de Londres. En d’autres termes, qu’il y avait aussi, désormais une « maçonnerie française ».
Sans doute, la référence historique à Wharton n’est pas spécialement reluisante pour un événement « fondateur » – mais on ne choisit pas ses ancêtres…
Un Ordre maçonnique ou une Grande Loge ?
Que faut-il donc penser des affirmations reprises depuis par plusieurs Obédiences, à commencer par le Grand Orient de France puis la Grande Loge de France, selon lesquelles leur propre fondation remonterait à 1728 – au point que cette date a remplacé, sur leurs sceaux respectifs, celles qui y avaient toujours figuré : 1736 (?), 1773 et 1894 – ou s’y est ajouté, ce qui est plus subtil et traduit malgré tout un léger trouble de conscience ?…
Il faut simplement en penser que l’historiographie a toujours fait mauvais ménage avec la politique – fût-elle maçonnique – et peut-être surtout dans ce cas !
Que l’on soit clair : en 1728, la franc-maçonnerie – entendons par là : un réseau composé de quelques loges et d’une poignée de francs-maçons – était déjà présente en France depuis au moins quelques années, sinon deux ou trois décennies, même de façon ultra-confidentielle. En outre, ce qui s’est produit en 1728 n’est aucunement la création d’une structure – a fortiori de ce que nous nommons aujourd’hui une « Obédience » ! Aucun récit du temps ne fait mention de quoi que ce soit qui puisse se rapporter à une fondation quelconque cette année-là ! Au regard des francs-maçons de cette époque, 1728 fut un donc, je le répète, un non-événement…
Mais le témoignage de Mac Leane, sept ans plus tard, est pourtant riche de sens, je l’ai dit. On comprend que James Anderson, dans la deuxième édition des Constitutions publiée en 1738, indique que « Toutes ces loges étrangères [mentionnées précédemment dans le texte] sont sous la protection de notre Grand Maître d'Angleterre. Toutefois l'ancienne loge de la ville d'York et les loges d'Écosse, d'Irlande, de France et d'Italie, assumant leur indépendance, ont leur propre Grand-maître. » Il n’est pour autant pas explicitement question de « Grande Loge »…
En 1728, il n’y avait pas encore de Grande Loge, c’est une évidence, et Wharton fut qualifié de « Grand Maître » sans avoir à exercer la moindre prérogative – pour autant qu’il en ait été capable et qu’il en ait eu le goût – pendant son bref passage en France. Enfin, si après lui quelque uns des pionniers de la petite troupe parisienne des francs-maçons exilés, comme Derwenwater, assumeront l’appellation de Grand Maître, il ne faut pas se méprendre sur ce que cela veut dire. Au début des années 1740 encore, il sera d’usage de qualifier de « Grand Maître » ce que nous nommons depuis longtemps un Vénérable Maître. Cette coutume fut abandonnée vers le milieu de la décennie, au moment sans doute où, en décembre 1743, fut élu celui qui allait dominer de haute quoique lointaine autorité toute la maçonnerie en France pendant presque trente ans : Louis-Antoine de Bourbon-Condé, comte de Clermont (1709-1771), qui porta désormais le titre très significatif à ses yeux, de Grand Maitre[2]. Pendant cinq ans, le duc D’Antin, « premier Grand Maître français », l’avait théoriquement précédé, mais ce fut une ombre prématurément disparue et qui n’a pratiquement laissé aucune trace sur la franc-maçonnerie de son temps.
Désormais, il y avait donc un Grand Maître, mais un Grand Maître de quoi ? De la Grande Loge ? Pas du tout. Le titre constamment porté par Louis de Clermont, tout au long de sa vie, fut « Grand Maître des Loges régulières du Royaume de France » – le même titre que l’on attribue à Wharton en 1735 et dont il est supposé avoir joui en 1728. Le lieu n’est pas ici de revenir sur les origines et l’émergence du concept de Grande Loge de France au XVIIIe siècle – ce sera pour d’autres notes[3] – mais, de même qu’un Vénérable se nommait souvent « Grand Maître » de sa loge, je l’ai dit, il devint habituel de qualifier la Loge du Grand Maître – Saint Jean de Jerusalem, à Paris, dont les règlements furent rédigés en 1745 – de « Grande Loge », puisque c’était la loge du Grand Maître ! Pendant une bonne quinzaine d’années environ, la Grande Loge de ne sera guère autre chose que les quelques proches collaborateurs que Clermont chargera d’expédier en son nom les affaires maçonniques qu’il réglait dans « sa » loge, c’est-à-dire la « Grande Loge »…dont personne ne pensait qu’elle avait été créée en 1728, cela va de soi ! L’expression « Grande Loge de France » elle-même n’est d’ailleurs pas attestée sous cette forme avant 1737.
Faisons un rêve…
Tous ces points étaient parfaitement clairs en 2003 et je dois à la vérité de dire que les Grands Maîtres des Obédiences qui, depuis l’année précédente, avaient formé une sorte de rassemblement informel dénommé « La Maçonnerie Française », le savaient tous très bien et n’interprétaient pas différemment cette célébration d’une mémoire collective, symboliquement rapportée à une date ancienne et significative – mais qui n’appartenait à personne.

Quelques dignitaires avec le Président de la République
lors du 275e anniversaire
au Palais de l'Elysée
en juin 2003
1728 avait précisément l’avantage de se situer avant l’époque des Grandes Loges et a fortiori du Grand Orient. Cette date n’était pas une borne administrative destinée à être détournée par les uns et les autres mais une date idéale, renvoyant à un temps où il n’y avait encore en France qu’une seule maçonnerie « indifférenciée ».
Le train de l’histoire, depuis lors, est passé. Il a laissé sur son chemin des structures, des juridictions, des règlements, des administrations. Il a aussi fait naitre – c’était sans doute inéluctable – des chamailleries et des querelles souvent peu substantielles mais incroyablement durables.
En « inventant » 1728, nous voulions rêver à un temps idéal où la franc-maçonnerie française était unie parce qu’elle était libre dans sa diversité. Nous sommes tous les « enfants » de 1728, parce que cette année-là, précisément, rien n’a été créé, ni fondé, mais un constat a été fait par les francs-maçons alors présents sur le sol de France : il s’y trouvait désormais un ordre maçonnique vivant et indépendant. Il n’y a rien d’autre à en dire.
Si la réalité actuelle du « paysage maçonnique français » est parfois consternante – surtout depuis deux ans, et peut-être pour quelque temps encore – le rêve, quant à lui, demeure.
Veuille le Grand Architecte de l’Univers qu’en dépit de la bêtise ambiante, ce rêve-là ne s’évanouisse jamais tout à fait…
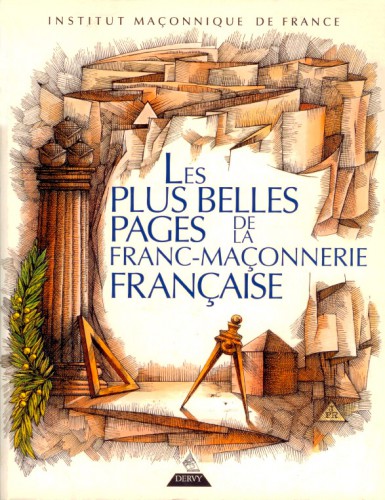
Le Livre Officiel
du 275eme anniversaire...
[1] Voir la magnifique synthèse de mon ami M. Scanlan, in Le Monde maçonnique des Lumières – Dictionnaire prosopographique, 3 vol., Paris 2013.
[2] Rappelons au passage que depuis le milieu du XVIIe siècle, ce fut presque toujours un Bourbon-Condé qui assuma la fonction de « Grand Maître de France », l’un des plus hauts offices du Royaume, ayant la haute main sur la Maison du Roi…
[3] J’ai cependant eu l’occasion de faire un point assez détaillé sur cette question dans l’introduction historique que la Grande Loge de France m’avait demandé de rédiger, en 1995, lorsqu’elle eut l’heureuse idée de publier un très beau fac similé du Livre d’architecture de la Très Respectable Grande Loge de France (1789-1798), une Grande Loge « maintenue » après la création du Grand Orient en 1773, et qui finit sa vie en 1799 par fusion avec ce même Grand Orient. Je n’ai pas grand-chose à changer à ce texte pour lequel les autorités de la Grande Loge de France, m’avaient exprimé leurs chaleureux remerciements. Ce dont je leur suis toujours reconnaissant – je parle évidemment de ses dignitaires de 1995, pas de ceux d’aujourd’hui…