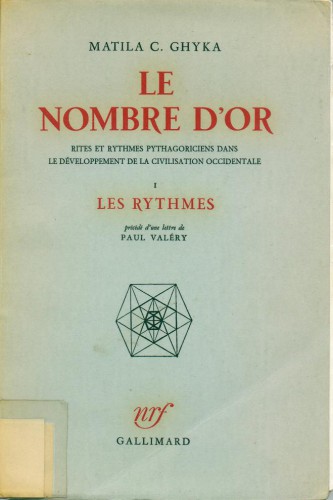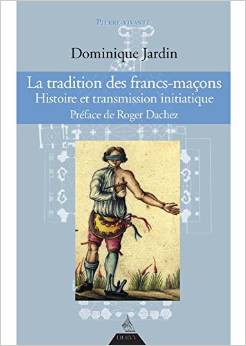
Dominique Jardin vient de publier un nouvel ouvrage que je souhaite recommander à toutes et à tous : les mots "tradition", "ésotérisme", sont en effet des mots piégés que l'on emploie souvent, en franc-maçonnerie, à tort et à travers. L'abord rigoureux et méthodique de Dominique Jardin, éclairé des acquis des sciences humaines, de l'anthropologie et des sciences religieuses, lui-même bien formé à l'exigeante approche de l’École Pratique des Hautes Études, donne à voir ce domaine sous un jour très nouveau.
Il m'a fait l'amitié de me demander une préface. Je vous livre ici ce texte que vous retrouverez en tête de son ouvrage - mais ce sont les pages qui la suivent que je vous conseille surtout de lire !...
PREFACE
Après nous avoir conviés à un Voyage dans les tableaux de loge en 2011 et nous avoir introduits, en 2012, au Temple ésotérique des francs-maçons, Dominique Jardin nous propose à présent le troisième volet de ce que j’inclinerai à considérer comme un triptyque indissociable. Il en est, à divers égards, le couronnement et la synthèse ouverte et je suis très heureux de pouvoir, dans le cadre de cette préface, suggérer quelques vues et indiquer quelques perspectives de travail que ce livre permettra d’explorer plus avant.
Une observation générale de méthode s’impose ici en tout premier lieu : l’abondante littérature qui, en France singulièrement, s’attache à « l’ésotérisme maçonnique », souffre classiquement d’une double faiblesse.
La première tient au fait que la définition de l’ésotérisme qui sous-tend nombre d’ouvrages s’apparente surtout au sens faible de ce mot, qui en fait un vocable dévalué, devenu un véritable fourre-tout conceptuel, situation fâcheuse dont témoigne le rangement que lui appliquent les libraires des grandes surfaces spécialisées, entre les livres consacrés aux OVNI et les innombrables opuscules portant sur les arts divinatoires : inquiétant voisinage, mais ô combien révélateur…
L’heureux a priori méthodologique de Dominique Jardin consiste à rattacher de nouveau ce champ d’études à l’approche académique du concept, dans le sillage, aujourd’hui impossible à ignorer, tracé par Antoine Faivre et ses études véritablement fondatrices depuis une quarantaine d’années. L’ésotérisme, en effet, n’est pas un corps de doctrine, une sorte de « science secrète » aux contenus d’autant plus incertains qu’ils apparaissent excessivement variables mais, pour reprendre une expression due à Jean-Pierre Laurant, un « regard » différent posé sur le monde [1]. L’ésotérisme maçonnique n’est donc que secondairement maçonnique, il est avant tout structuré par ce regard qui s’est constitué en Europe à la fin du XVème siècle. Ainsi l’ésotérisme – qui n’est qu’une des dimensions possibles de l’univers maçonnique mais ne le résume ni ne l’épuise [2] – appartient au vaste domaine des études philosophiques et théologiques, et aussi des expériences mystiques qui ont imprégné la trame de la pensée occidentale, dans le champ religieux comme dans le champ scientifique alors naissant, entre le XVIème et le XVIIIème siècle. En d’autres termes, il s’agit bien ici d’intégrer la pensée maçonnique à l’histoire culturelle de l’Europe.
La deuxième faiblesse de la « littérature » maçonnique tient à sa méconnaissance très habituelle de la distinction pourtant essentielle entre l’emic et l’etic.
Initialement empruntée aux études linguistiques, cette alternative de consonance bizarre est aujourd’hui largement utilisée dans le champ des sciences humaines. Eclairons-là en quelques mots – fût-ce au risque de la schématiser un peu.
La perspective emic est celle qui tente de comprendre « de l’intérieur » une démarche, une activité, un comportement, un code. C’est la langue qu’on parle, quand on est un locuteur naturel de cette langue ; le rite qu’on accomplit quand on ne s’interroge pas sur une tradition venue « du fond des temps » et qu’on met simplement en œuvre ; le geste qui s’impose à nous dans une situation émotionnelle donnée et qui nous a été léguée par notre éducation et fait partie de notre « schéma corporel ». C’est, en quelque sorte, la vie saisie dans la spontanéité de son déroulement.
La perspective etic, c’est « l’arrêt sur image ». Le cliché ou l’enregistrement pris par l’ethnographe, document désormais pétrifié – pour le bon motif – et qui devient objet d’étude, s’offre à la déconstruction, à la comparaison distanciée, à l’analyse structurale. Elle n’abolit pas la vie (l’emic) mais elle lui adjoint une grille d’interprétation possible, détachée de tout a priori.
On voit quelle application nous pouvons en faire : le travail en loge, c’est l’emic de la franc-maçonnerie, et la maçonnologie sera son etic. Refuser de reconnaitre l’intérêt d’une approche distanciée de l’enseignement maçonnique au motif qu’on ne l’a pas « vécu de l’intérieur », objection sympathique mais niaise, revient tout simplement à s’interdire toute connaissance significative des religions et des cultures du monde, c’est-à-dire à disqualifier tous les acquis de l’ethnographie, de l’anthropologie culturelle et de la science comparée des religions depuis plus d’un siècle : on voit à quelle absurdité conduit une telle position…
Dès lors qu’il s’est affranchi de ces deux limites – ignorer l’histoire culturelle et répudier la réflexion au nom de la vie – Dominique Jardin nous fait découvrir deux pièges dans lesquels le discours maçonnique en général, et celui qui porte sur l’ésotérisme maçonnique en particulier, n’est que trop souvent tombé.
Le premier piège consiste à penser que la « tradition » maçonnique – et la connotation ésotérique qu’on lui assigne – s’origine à un passé réellement situé dans l’histoire et s’est trouvée dotée jusqu’à nous d’une structure intangible et pérenne. A cette vision essentialiste, qui conduit aux pires impasses, Dominique Jardin substitue une démarche historienne qui n’est aucunement réductrice. Il pose, avec toute une école qui a produit des travaux d’une fécondité remarquable depuis quelques décennies, que la tradition a en effet une histoire.
C’est donc en termes d’emprunts, d’ajouts et de perfectionnements successifs, bien plus que transmission intacte et de filiation ininterrompue, qu’il convient de rechercher les raisons de l’état final de ce que nous nommons commodément – mais parfois trompeusement – la « tradition maçonnique ». La franc-maçonnerie spéculative a été un monde en genèse pendant environ 150 ans, si l’on admet des bornes larges qui la font surgir au milieu du XVIIème siècle et en situent l’achèvement relatif à la fin du Siècle des Lumières. La déconstruction méthodique de Dominique Jardin ne détruit donc pas l’édifice mais en fait simplement réapparaitre la dynamique de constitution. Un travail collectif, sans plan concerté et qui, du reste, n’est peut-être pas terminé
Car le deuxième piège consiste justement à essentialiser encore, cette fois non plus seulement la « tradition maçonnique » en elle-même, mais ce que chacun en a reçu, ici et maintenant, au sein du monde maçonnique complexe et pluriel dont l’histoire nous a faits les cohéritiers. En d’autres termes, rien n’est plus dangereux, ni surtout plus erroné, que d’envisager la tradition maçonnique à l’aune seule du Rite particulier au travers duquel nous y avons eu accès. Seule est féconde l’approche comparatiste, qui scrute dans tous les Rites – dont chacun est en soi une somme parmi d’autres possibles – les reliefs d’une tradition perdue, par nature inaccessible et nécessairement fantasmée, dont chaque Rite est plus ou moins le dépositaire, mais toujours au terme d’un « tri », pour reprendre l’heureuse expression de Dominique Jardin. Un tri qui donne cohérence à chaque système qui, cependant, n’est vrai qu’en ce qu’il affirme et demeure faux en ce qu’il nie ou méconnait simplement.
Pour ne donner ici qu’un exemple de ce dont les deux ouvrages précédents de Dominique Jardin ont fourni une éclatante démonstration iconographique et que l’étude des événements et des structures de la maçonnerie au XVIIIème siècle confirme sans peine, quand comprendra-t-on que le mot « écossisme » ne désigne aucune tradition maçonnique particulière, et encore moins un Rite parmi les autres, mais la culture commune, indivise, foisonnante et unanimement partagée des hauts grades maçonniques, en France comme en Grande-Bretagne – et, dans ce dernier cas, bien davantage en Angleterre qu’en Écosse, du reste ! – entre les années 1730 et la fin du Siècle des Lumières ? Quand prendra-t-on conscience – ou aura-t-on l’honnêteté d’admettre enfin – que les trois Rites commodément retenus par Dominique Jardin pour ordonner ses comparaisons, à savoir le Rite Français – qu’on ne nommera ainsi qu’au début du XIXème siècle mais existait depuis bien plus longtemps –, le Rite Ecossais Ancien et Accepté – qui ne se constitue comme tel qu’à la même époque, précisément – et le Rite Ecossais Rectifié – qui, pour le coup, mérite d’être tenu pour le plus ancien, puisque déjà achevé dans le dernier quart du XVIIIème siècle – sont tous des « écossismes » ?...
Éviter ces deux pièges ouvre aux études maçonnologiques – et donc aussi au « vécu » maçonnique qui doit s’en nourrir – des territoires jusque-là, sinon inexplorés, du moins largement méconnus. A divers égards, Dominique Jardin en aura été le défricheur.
Reste un dernier point que je voudrais mentionner. De même que je pense avoir été l’un des premiers en France à souligner combien la notion de « tradition inventée », forgée par Hobsbawm permettait d’éclairer puissamment la nature essentielle de la franc-maçonnerie, de même, il faut être reconnaissant à Dominique Jardin de s’être emparé du très fructueux concept de religio duplex proposé récemment par Jan Assmann, dans un livre magnifique. C’est, me semble-t-il, la clé qui rend possible une approche intelligente – et non plus à coups de postures – de la question si délicate en France des relations entre la pensée maçonnique et l’ordre religieux. Entre le négationnisme désespéré de certains – qui refusent de voir ce qui pourtant relève de l’évidence historique : à son origine, la franc-maçonnerie spéculative est chrétienne et elle en porte durablement les marques – et l’intégrisme paradoxal de ceux qui, par exemple, en viendraient à en faire une sorte de tiers-ordre catholique (à moins qu’il ne soit orthodoxe !), la lecture d’Assmann suggère, non une voie moyenne – la vérité n’est que rarement la demi-somme des erreurs opposées – , mais une voie différente.
On peut en effet qualifier l’influence des Lumières sur la franc-maçonnerie, comme on l’a souvent fait, en lui attribuant une certaine rationalité individualiste qui assurait la promotion d’un être enfin libre et détaché de ses conditionnements civils et religieux, et dont une maçonnerie de plus en plus « libérale » aurait été le vecteur idéal. On peut aussi, et la reprise de Dominique Jardin nous y invite, en faire une autre lecture : au crépuscule de leur siècle, les Lumières auraient insinué dans la franc-maçonnerie, idéalement formatée pour cette fin, le projet subtil d’une religion intérieure, dans une Europe encore unanimement chrétienne mais gagnée par le doute à l’égard des formulations dogmatiques et des particularismes ecclésiaux – ce qui, en première instance, rappelle singulièrement la réserve déjà exprimée par Anderson dans le Titre Ier des Constitutions de 1723, à l’égard des « confessions et dénominations ».
Il existe toutefois une différence essentielle entre le texte d’Anderson – souvent très mal compris par des lecteurs contemporains qui y projettent volontiers leurs propres enjeux et oublient le contexte de sa rédaction initiale – et le projet des Lumières, si du moins l’on suit Jan Assmann. Anderson ne prônait aucunement une religion naturelle, vaguement déiste, comme on le dit trop souvent. Les « confessions et dénominations qui aident à distinguer [les hommes] » sont à ses yeux incontournables, dans la pure tradition du communautarisme anglo-saxon, en grande partie toujours vivant, qui fait de l’appartenance religieuse l’une des composantes de l’identité sociale. Il souhaite simplement qu’on surmonte ces barrières, non qu’on les abolisse. En revanche, le religio duplex opère un subtil déplacement de la problématique : si la référence à une transcendance – nommée ou innommable – est toujours présente et ne saurait disparaitre aussi facilement, c’est à une intériorisation complète de la perspective religieuse, jusque-là exclusivement « ecclésiale », que nous sommes conviés. De même que le Temple de Salomon est idéalisé – « spiritualisé » dit déjà en 1688 John Bunyan, qui ne fut jamais franc-maçon –, de même l’édifice symbolique de la maçonnerie, à travers ses tableaux et ses rituels, nous propose un voyage intérieur qui, à la classique « fidélité » religieuse, substitue la quête intérieure. La franc-maçonnerie, vers la fin du XVIIIème siècle, en est ainsi devenue aux yeux de certains, pour un temps – celui de sa pleine maturité, avant celui d’une relative altération – l’un des lieux électifs. En cela du reste, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, la maçonnerie d’Anderson apparait nettement plus religieuse, au sens classique du terme, et celle de la fin du siècle beaucoup plus « initiatique ». Mais cette dernière, à son tour, dans un monde contemporain désormais fortement sécularisé, apparait de nouveau à certains d’entre nous comme fâcheusement teintée de marqueurs religieux – et elle l’est en effet…
Dans ce jeu de miroirs et de renvois incessants, Dominique Jardin inscrit son livre dans une vaste entreprise de décryptage scientifique – n’ayons pas peur des mots ! – de la franc-maçonnerie, évidemment très au-dessus des platitudes habituelles des « manuels de symbolisme » et des exégèses personnelles plus ou moins inspirées. Si cette approche suscite encore de la méfiance dans les milieux maçonniques les plus « traditionnels » – ou qui se proclament tels – comment s’en étonner, mais aussi pourquoi s’en émouvoir ?
Pour paraphraser une formule célèbre, si un peu de maçonnologie semble éloigner de la maçonnerie, beaucoup y ramène, pour notre plus grand bonheur…
Roger Dachez
Président de l'Institut maçonnique de France
[1] J.-P. Laurant, Le regard ésotérique, Paris, 2001.
[2] Je m’étais déjà attaché à en montrer le caractère problématique dans l’entrée « Freemasonry », in Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (Dir. W. Hanegraaf, A. Faivre, R. van den Brock, J.-P. Brach), 2 vol., Leiden, 2003, 382-388.



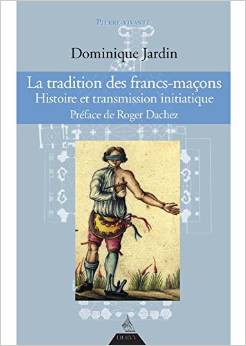
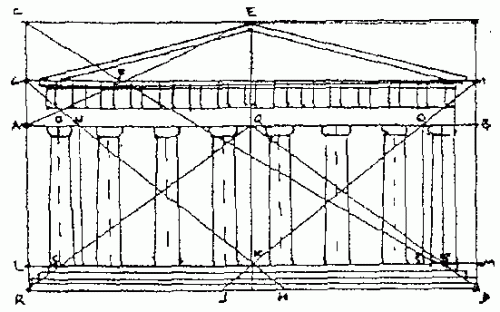

 haut, d’avoir véritablement « inventé » le Nombre d’or auquel il donnera une signification tout à fait nouvelle. Dans deux ouvrages publiés entre 1927 et 1931
haut, d’avoir véritablement « inventé » le Nombre d’or auquel il donnera une signification tout à fait nouvelle. Dans deux ouvrages publiés entre 1927 et 1931