Une question intéressante, qui donne lieu à des interprétations et des pratiques variées au sein des obédiences maçonniques en France, concerne les qualifications que l’on peut ou doit exiger d’un Frère ou d'une Soeur pour être promu(e) à un grade nouveau, a fortiori s’il s’agit des hauts grades qui font approcher du terme de la « carrière ». Schématiquement deux conceptions s’opposent.
1. La première, qui prévaut largement en France, est qu’un grade s’obtient au mérite. Entendons par là qu’un Frère ou une Soeur, éprouvé(e) quelques années – parfois de (trop) longues années – dans le dernier grade reçu, doit montrer par son assiduité, sa fidélité à sa loge ou à son chapitre, mais aussi par les travaux philosophiques ou symboliques présentés, qu’il (elle) a su assimiler les enseignements de ce grade et que par conséquent, au terme d’un cheminement suffisant et confirmé, on peut accorder le bénéfice d’un grade nouveau comme une sorte de récompense de son travail et de son implication.
Une telle vision des choses peut sembler a priori assez raisonnable et se justifie par le souhait de ne promouvoir que des candidats sérieux et conscients des efforts nécessaires pour tirer des enseignements de la franc-maçonnerie tout le bénéfice qu’ils peuvent en attendre. C’est aussi d'eux qu’on peut espérer le plus de dévouement envers leur loge, pour le bénéfice de tous.
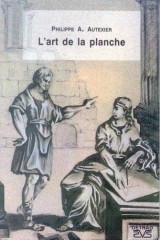
Le bachotage maçonnique suscite à son tour une littérature florissante
En revanche, il existe plus d’un revers à la médaille. Le premier est que l’espérance d’un grade comme une récompense que l’on doit mériter peut engendrer un état d’esprit sinon « carriériste », du moins opportuniste ou en tout cas conformiste. Si en dépit du temps passé, et malgré des efforts « méritoires », rien ne vient, c’est aussi le découragement, voire l’amertume qui menacent. On en connait de nombreux exemples : personne ne gagne rien à cette stratégie un peu puérile. En outre, dans certains milieux obédientiels et certains Rites, cette procédure permet parfois d’exercer des pressions sur les Frères et les Soeurs ou, à tout le moins, d’obtenir leur docilité pour servir d’autres intérêts que les leurs…et que ceux la franc-maçonnerie, disons-le clairement ! Il ne s’agit nullement, en l’occurrence, de quoi que ce soit de répréhensible ou de malhonnête, cela va sans dire, mais il faut savoir qu’un certain pouvoir régnant sur des systèmes de hauts grades se maintient parfois ainsi : tragique illusion d’une autorité mondaine dans un domaine où l’on devrait être conscient – surtout quand on est un « haut initié » – que les dignités ne sont que formelles et purement symboliques.
2. Dans une vision très anglo-saxonne, la Loge Nationale Française (LNF) a couramment adopté une autre pratique. Elle s’inspire du reste des usages fort répandus dans la première maçonnerie française, celle du milieu du XVIIIème siècle : les grades ne se "méritent" pas, ils s’obtiennent plutôt sans effort majeur pour peu que l’on soit raisonnablement assidu et manifestement de bonne volonté. Il n’est généralement pas nécessaire pour y accéder d’attendre de nombreuses années – sauf cas d’espèce – ni de produire d’innombrables travaux en loge ou d’être soumis à l’examen de multiples commissions – toutes procédures ailleurs très communes. En revanche, lorsque des grades sont donnés à un Frère, il appartient alors à celui qui les reçoit de les étudier, pendant des années s’il le faut, pour s’en approprier le contenu initiatique. Il vaut mieux, après tout, entamer au plus tôt ce travail que de se trouver en mesure de le commencer à un âge où l’on devrait déjà songer à en tirer les conclusions !
Dès les premiers temps de son initiation, un Frère est informé de l’existence des hauts grades et ceux qui en sont titulaires ne lui pas inconnus et n’en font pas plus de mystère qu’ils n’en tirent de vaine gloire. On dit aussi à tout Apprenti que le terme désirable de son parcours, en quelques années, sera de pouvoir, à son tour, contempler les cimes symboliques de son Rite et que c’est même tout le bonheur qu’on lui souhaite. Tout au long du chemin, ce sont des outils qu’on lui procure, des marques de confiance qu’on lui témoigne.
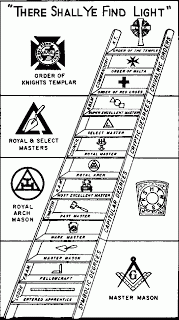
Un franc-maçon américain peut espérer gravir
cette impressionnante échelle
en quelques semaine ou mois, et sans la moindre planche...
Cette relative facilité d’accès aux différents grades – et notamment aux plus hauts d’entre eux – choque parfois les conceptions maçonniques qui prévalent en France et peut même être jugée par certains francs-maçons comme dénotant un laxisme regrettable, voire une sorte de coupable « braderie » des grades maçonniques ! Il faut ici rappeler que dans une maçonnerie tout à fait "régulière", celle des USA, on peut aujourd'hui recevoir les trois premiers grades en une matinée ('One-Day Class") et gravir jusqu'au 32ème "degré" du REAA en un weekend ! Dira-t-on qu'il s'agit de folies américaines ? C'est pourtant bien aux Etats-Unis que certains recherchent aujourd'hui frénétiquement la sacro-sainte "reconnaissance". Mais c'est là, admettons-le, un autre sujet. Encore que...
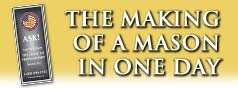
Devenir (Maître) Maçon en une journée !
Une pratique habituelle aux USA...
S'agissant de la très sage Angleterre, elle n'est d'ailleurs pas en reste : sur chaque convocation de sa loge bleue, un maçon anglais est informé que pour parvenir à "l'Ordre Suprême du Saint Arc Royal de Jérusalem" [1], il suffit d'en faire la demande et d'avoir au moins...un mois d'ancienneté dans le grade de maître ! Avec un humour tout britannique, le site officiel du Suprême Grand Chapitre d'Angleterre précise que si un Frère ne sait à qui s'adresser à ce sujet, il pourra identifier les membres de l'Arc Royal à la médaille spécifique qu'ils portent en loge, et qu'ils seront ravis ("They will be delighted") de transmettre leur demande...
On peut évidemment comprendre les critiques françaises de ces usages, et elles témoignent sans doute – du moins veut-on le croire – d’un sincère respect pour la franc-maçonnerie, mais on peut aussi à bon droit ne pas du tout les partager.

Le Saint Arc Royal de Jérusalem :
"la racine, le coeur et la moelle" de la franc-maçonnerie
Un mois d'ancienneté dans le grade de Maître !
Tout d’abord parce que ces dispositions ont permis à la LNF, depuis sa fondation, d’éviter tous les écueils mentionnés plus haut : pas d’angoisse de progression – ou de non-progression ! –, pas de bachotage maçonnique, pas davantage d’orgueil mal placé de la part des « hauts gradés », et enfin des organismes de hauts grades en harmonie avec les loges bleues, animés par des Frères uniquement préoccupés de transmettre et de partager, non de conserver et de retenir, moins encore de régir et de dominer.
Mais il y a dans ce choix un bénéfice bien plus fondamental, car le point majeur est le suivant : sachant que tous les secrets maçonniques sont de Polichinelle, ayant tous été publiés depuis plus de deux siècles, que chacun peut se les procurer pour quelques euros dans toutes les bonnes librairies ou même simplement sur Internet, l’essentiel n’est plus vraiment de protéger des enseignements et des rituels qui possèdent un caractère pratiquement public. On peut ici utilement recourir, une fois n'est pas coutume, à une distinction sur laquelle a beaucoup et judicieusement insisté René Guénon : celle qui existe entre "l’initiation virtuelle" et "l’initiation effective". Pour le dire simplement et en quelques mots, une cérémonie maçonnique ne fait que conférer la possibilité de découvrir et d’intégrer un jour le contenu initiatique d’un grade, c’est l’initiation virtuelle. L’initiation effective, que nul ne peut prétendre atteindre, est le but de la quête, le terme espéré du travail maçonnique et ne se révélera que dans le cœur de l’initié qui lui seul, un jour peut-être, le saura : nul autre que lui ne peut en être juge. Sa propre conscience sera toujours, en l’espèce, un tribunal infaillible.
A la LNF, quel que soit son Rite d’appartenance, un Frère qui respecte ses engagements normaux à l’égard de sa loge peut espérer, dans un temps raisonnable, de l’ordre de quelques années à peine, gravir tous les échelons de ce Rite. Mais, parvenu au « sommet », il aura souvent entendu dire qu’il ne possède aucun grade et que nul franc-maçon, si savant soit-il, n’en possède jamais aucun, au demeurant. Mais que chacun doit espérer être un jour « possédé » – au sens positif et non démoniaque du terme, on s’en doute – par les grades qui lui ont été confiés, dont les portes lui ont été ouvertes, dont l’expérience concrète lui a été permise.
On objecte parfois qu’une telle pratique fait courir le risque de donner des grades à des Frères (ou des Soeurs) qui n’en feront rien, n’étant pas « qualifiés », depuis le début, pour les recevoir. Certes, ce risque existe, mais la méthode classique en France, faite de longues attentes et d’examens scolaires – sans compter beaucoup de sage obéissance –, offre-t-elle vraiment de meilleures garanties ? L’expérience permet honnêtement d’en douter…
Au pire, on rencontrera sans doute des maçons qui ne comprendront jamais rien d’essentiel à la maçonnerie : ce genre d’erreur est en effet possible mais finalement de peu de conséquence. La franc-maçonnerie a certainement connu cela depuis ses origines et elle ne s’en est pas moins bien portée, au point qu’elle est parvenue jusqu’à nous saine et sauve, semble-t-il ! Le plus grave n’est donc pas de « donner des perles aux pourceaux » pour reprendre la rude expression évangélique, ce serait plutôt, comme on le disait joliment au XVIIIème siècle, de ne pas répondre à un « vray désir ».
Il faut toujours donner sa chance à la franc-maçonnerie et, aussi souvent que possible, laisser la leur aux francs-maçons…

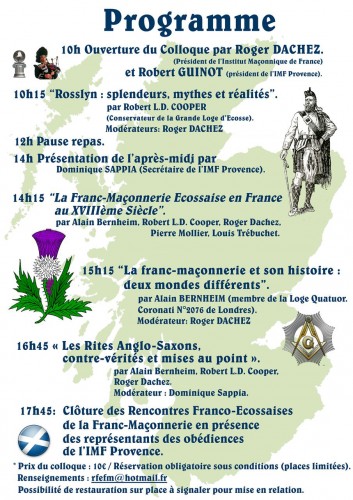
 Le cas sans doute le plus remarquable est celui de l’Ordre des Elus Coëns, propagé dès les années 1760 par Martinès de Pasqually (1727-1774). Ce système, d’apparence maçonnique, commençait par les trois grades d’apprenti, de compagnon et de maître, à l’instar de toute la maçonnerie, mais poursuivait un but bien spécifique: la théurgie. Puisant à des sources encore partiellement obscures, Martinès de Pasqually proposait à la fois une doctrine qu’il résuma plus tard dans son Traité de la Réintégration, et une pratique visant à provoquer, lors des cérémonies complexes de l’Ordre, la manifestation d’esprits supérieurs. Selon Martinès, les deux approches étaient liées. La doctrine expliquait l’état de chute de l’homme, la nécessité de sa « réconciliation » avec son créateur, préludant à la fin des temps où pourrait s’opérer la « réintégration » de tout l’univers dans l’unité divine. Au cours des rituels (opérations), les esprits étaient convoqués et leur présence attestait que le candidat avait été agréé par eux. Le grade suprême de Réau-Croix était supposé placer le candidat dans l’état virtuel de « réconciliation ».
Le cas sans doute le plus remarquable est celui de l’Ordre des Elus Coëns, propagé dès les années 1760 par Martinès de Pasqually (1727-1774). Ce système, d’apparence maçonnique, commençait par les trois grades d’apprenti, de compagnon et de maître, à l’instar de toute la maçonnerie, mais poursuivait un but bien spécifique: la théurgie. Puisant à des sources encore partiellement obscures, Martinès de Pasqually proposait à la fois une doctrine qu’il résuma plus tard dans son Traité de la Réintégration, et une pratique visant à provoquer, lors des cérémonies complexes de l’Ordre, la manifestation d’esprits supérieurs. Selon Martinès, les deux approches étaient liées. La doctrine expliquait l’état de chute de l’homme, la nécessité de sa « réconciliation » avec son créateur, préludant à la fin des temps où pourrait s’opérer la « réintégration » de tout l’univers dans l’unité divine. Au cours des rituels (opérations), les esprits étaient convoqués et leur présence attestait que le candidat avait été agréé par eux. Le grade suprême de Réau-Croix était supposé placer le candidat dans l’état virtuel de « réconciliation ». 
 Willermoz remania le système et y intégra la doctrine martinèsiste tout en renonçant à la théurgie, ajoutant au sommet de la pyramide des grades deux classes secrètes, les Profès et les Grands Profès, dont la cérémonie de réception consistait exclusivement en la lecture d’un copieux discours d’instruction qui résumait les point majeurs de la doctrine martinèsiste et les appliquait au symbolisme maçonnique.
Willermoz remania le système et y intégra la doctrine martinèsiste tout en renonçant à la théurgie, ajoutant au sommet de la pyramide des grades deux classes secrètes, les Profès et les Grands Profès, dont la cérémonie de réception consistait exclusivement en la lecture d’un copieux discours d’instruction qui résumait les point majeurs de la doctrine martinèsiste et les appliquait au symbolisme maçonnique. 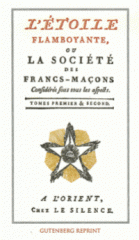 Un autre courant ésotérique en faveur au sein de la maçonnerie dès le 18ème siècle fut le courant alchimique. Par le biais de la tradition rosicrucienne, introduite au début du 17ème siècle en Allemagne, et dont les échos étaient encore largement perçus en Europe, des grades d’inspiration hermétique vont apparaître – comme le Chevalier du Soleil vers 1750 – et parfois structurer un système maçonnique tout entier, comme on peut le voir dans le livre du baron de Tschoudy, L’Etoile Flamboyante, publié en 1766, décrivant une très imaginaire Société des Philosophes Inconnus, ou plus tard, en Allemagne à partir de 1777, les Rose-Croix d’Or d’Ancien Système qui vécurent pendant une dizaine d’années, mêlant au thème alchimique la fable templière. Citons encore le Rite Ecossais Philosophique qui connaîtra un certain succès en France à la fin du 18e et dans les premières années du 19ème siècle.
Un autre courant ésotérique en faveur au sein de la maçonnerie dès le 18ème siècle fut le courant alchimique. Par le biais de la tradition rosicrucienne, introduite au début du 17ème siècle en Allemagne, et dont les échos étaient encore largement perçus en Europe, des grades d’inspiration hermétique vont apparaître – comme le Chevalier du Soleil vers 1750 – et parfois structurer un système maçonnique tout entier, comme on peut le voir dans le livre du baron de Tschoudy, L’Etoile Flamboyante, publié en 1766, décrivant une très imaginaire Société des Philosophes Inconnus, ou plus tard, en Allemagne à partir de 1777, les Rose-Croix d’Or d’Ancien Système qui vécurent pendant une dizaine d’années, mêlant au thème alchimique la fable templière. Citons encore le Rite Ecossais Philosophique qui connaîtra un certain succès en France à la fin du 18e et dans les premières années du 19ème siècle.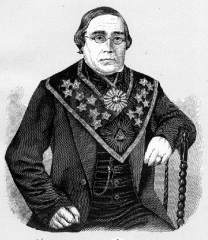 Dans un tout autre registre, la campagne d’Egypte conduite par Bonaparte entraînera, avec la vogue de l’égyptomanie, la création au début du 19ème siècle des Rites Egyptiens de la maçonnerie, permettant à leurs auteurs d’introduire dans les rituels maçonniques des références aux mystères antiques et une vision très romantique de « l’ésotérisme égyptien », notamment exposée par Jacques Etienne Marconis de Nègre (1796-1868) (L’Hiérophante, développement complet des mystères maçonniques, 1839). Dans la première moitié du 20ème siècle, les héritiers de ce courant, notamment dans le cadre des Rites de Memphis et de Misraïm dont l’histoire fut extrêmement agitée et parfois navrante, témoigneront de la présence au sein de la maçonnerie d’une mouvance ésotérique affirmée, mais souvent intellectuellement confuse.
Dans un tout autre registre, la campagne d’Egypte conduite par Bonaparte entraînera, avec la vogue de l’égyptomanie, la création au début du 19ème siècle des Rites Egyptiens de la maçonnerie, permettant à leurs auteurs d’introduire dans les rituels maçonniques des références aux mystères antiques et une vision très romantique de « l’ésotérisme égyptien », notamment exposée par Jacques Etienne Marconis de Nègre (1796-1868) (L’Hiérophante, développement complet des mystères maçonniques, 1839). Dans la première moitié du 20ème siècle, les héritiers de ce courant, notamment dans le cadre des Rites de Memphis et de Misraïm dont l’histoire fut extrêmement agitée et parfois navrante, témoigneront de la présence au sein de la maçonnerie d’une mouvance ésotérique affirmée, mais souvent intellectuellement confuse.
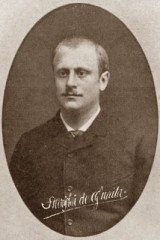 en revanche rencontrer une certaine faveur, alors même que la maçonnerie connaissait, dans ce pays, une évolution surtout laïque et humaniste, plus soucieuse d’engagement social que de spéculation mystique. Il faut citer ici l’œuvre d’Oswald Wirth (1860-1943), héritier spirituel de Stanislas de Guaita (1861-1897), lui-même l’un des fondateurs de l’occultisme parisien dans les années 1880. Dans une série d’ouvrages très populaires parmi les maçons français, Wirth exposera une conception du symbolisme maçonnique inspirée par une vision très personnelle de l’alchimie et du magnétisme (La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, 1894-1922; Le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’alchimie et la franc-maçonnerie, 1910). Son influence demeure vivante dans les milieux maçonniques français mais n’a guère eu d’écho en dehors des pays francophones. On doit cependant en rapprocher toute une littérature à prétention ésotérique, naguère influencée par le New Age, et qui voit aujourd’hui dans la maçonnerie le lieu possible d’un nouvelle synthèse entre les enseignements de grands courants religieux et mystiques, indistinctement mêlés, et les acquis les plus troublants – et souvent fort mal compris – de la science contemporaine.
en revanche rencontrer une certaine faveur, alors même que la maçonnerie connaissait, dans ce pays, une évolution surtout laïque et humaniste, plus soucieuse d’engagement social que de spéculation mystique. Il faut citer ici l’œuvre d’Oswald Wirth (1860-1943), héritier spirituel de Stanislas de Guaita (1861-1897), lui-même l’un des fondateurs de l’occultisme parisien dans les années 1880. Dans une série d’ouvrages très populaires parmi les maçons français, Wirth exposera une conception du symbolisme maçonnique inspirée par une vision très personnelle de l’alchimie et du magnétisme (La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, 1894-1922; Le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’alchimie et la franc-maçonnerie, 1910). Son influence demeure vivante dans les milieux maçonniques français mais n’a guère eu d’écho en dehors des pays francophones. On doit cependant en rapprocher toute une littérature à prétention ésotérique, naguère influencée par le New Age, et qui voit aujourd’hui dans la maçonnerie le lieu possible d’un nouvelle synthèse entre les enseignements de grands courants religieux et mystiques, indistinctement mêlés, et les acquis les plus troublants – et souvent fort mal compris – de la science contemporaine.